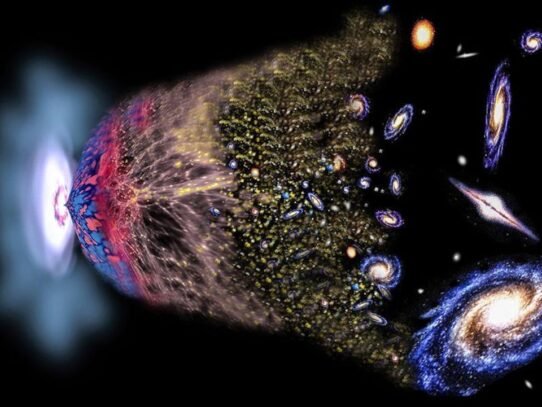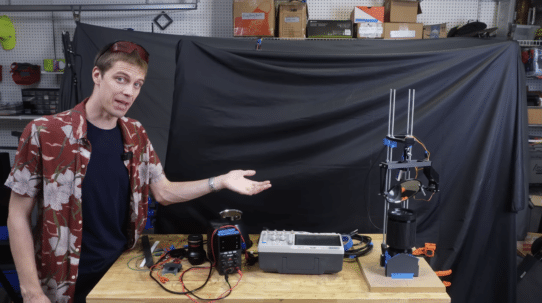Quand on parle de comètes, on pense souvent à des objets glacés liés au Soleil, tournant sur des orbites plus ou moins elliptiques. 3I/ATLAS casse totalement ce schéma. Cette comète ne vient pas de notre Système solaire, elle le traverse simplement avant de repartir pour toujours dans l’espace interstellaire. Et rien que ce détail en fait déjà un objet fascinant.
Mais avant de plonger dans son histoire et ce qu’elle nous apprend, commençons par répondre à une question simple : pourquoi l’appelle-t-on 3I/ATLAS ? Ce nom un peu étrange est en réalité un résumé de sa nature, de son origine et de son histoire d’observation.
Table des matières
3I/ATLAS, c’est quoi exactement ?

3I/ATLAS est une comète interstellaire, c’est-à-dire un objet qui ne s’est pas formé dans notre Système solaire mais qui en est un visiteur de passage. Sa trajectoire est hyperbolique, ce qui signifie qu’elle ne suit pas une orbite fermée autour du Soleil et qu’elle ne reviendra jamais une fois repartie.
Elle a été découverte le 1ᵉʳ juillet 2025 par un télescope du réseau ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) installé au Chili. Lors de sa détection, elle se trouvait déjà à plusieurs unités astronomiques de la Terre et se rapprochait du Soleil à grande vitesse. Rapidement, les calculs d’orbite ont montré que sa trajectoire ne pouvait pas être expliquée par une simple orbite cométaire classique : 3I/ATLAS venait de l’espace interstellaire.
C’est seulement le troisième objet interstellaire jamais observé dans notre voisinage après 1I/ʻOumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019. Cette rareté explique l’enthousiasme de la communauté scientifique : chaque interstellaire est une sorte d’échantillon gratuit envoyé par une autre étoile.
Pourquoi ce nom 3I/ATLAS ?
Le nom 3I/ATLAS n’a rien de marketing, il suit en réalité une logique très stricte définie par l’Union astronomique internationale. On peut le découper en deux morceaux : « 3I » et « ATLAS ».
Le « 3I » : troisième objet interstellaire
La première partie, « 3I », indique que 3I/ATLAS est le troisième objet interstellaire officiellement reconnu :
- 1I/ʻOumuamua, détecté en 2017
- 2I/Borisov, découvert en 2019
- puis 3I/ATLAS, confirmé en 2025
La lettre « I » signifie « interstellar », pour rappeler que l’objet n’est pas lié au Soleil par une orbite fermée mais qu’il vient de l’espace entre les étoiles. Le chiffre devant la lettre est un simple numéro d’ordre dans la liste des objets interstellaires confirmés.
Autrement dit, dès que les astronomes ont validé que l’orbite de l’objet était hyperbolique et incompatible avec une origine locale, il a reçu cette désignation officielle : troisième objet interstellaire, donc 3I.
Le « ATLAS » : le nom du programme de surveillance
La seconde partie du nom, « ATLAS », vient du réseau de télescopes qui l’a découvert : l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Ce programme, financé par la NASA, surveille le ciel pour détecter les objets susceptibles de s’approcher de la Terre, en particulier les astéroïdes potentiellement dangereux.
Comme la tradition le veut, une comète porte souvent le nom de son découvreur ou de l’instrument qui l’a repérée. Ici, c’est donc tout simplement le système ATLAS qui donne son nom à 3I/ATLAS.
Pour compliquer un peu les choses, la comète possède aussi une désignation cométaire plus classique : C/2025 N1 (ATLAS). Le « C » signale une comète non périodique, « 2025 N1 » indique l’année et la quinzaine de découverte, et « ATLAS » rappelle encore une fois le programme qui l’a trouvée.
En résumé, on l’appelle 3I/ATLAS parce que :
- c’est le troisième objet interstellaire catalogué « 3I »,
- il a été découvert par le survey ATLAS.
Le nom contient donc à la fois sa nature et son histoire d’observation.
Un voyageur venu d’un autre système stellaire
L’un des aspects les plus fascinants de 3I/ATLAS, c’est qu’elle n’a pas la même « carte d’identité » que les comètes de notre Système solaire. Les calculs montrent qu’elle a passé des milliards d’années à voyager dans la Voie lactée avant de croiser la route du Soleil. Certaines études estiment même que 3I/ATLAS pourrait être plus vieille que notre Système solaire, avec un âge compris entre 7 et 14 milliards d’années selon les scénarios, ce qui en ferait l’une des comètes les plus anciennes jamais observées.
Impossible de remonter à son étoile d’origine avec certitude. Après autant de temps, les trajectoires des étoiles dans la galaxie se sont mélangées, et 3I/ATLAS a probablement subi plusieurs perturbations gravitationnelles au fil de ses rencontres avec d’autres systèmes stellaires. Elle a dû être éjectée de son système natal, sans doute sous l’effet d’une interaction avec une planète géante ou une étoile voisine.
Pour les chercheurs, c’est une opportunité unique : analyser 3I/ATLAS revient à sonder les conditions de formation d’un autre système planétaire, ailleurs dans la galaxie.
Une trajectoire éclair à travers le Système solaire
3I/ATLAS se déplace à une vitesse vertigineuse, de l’ordre de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde par rapport au Soleil, ce qui représente plus de 200 000 à 250 000 km/h. Elle suit une trajectoire hyperbolique qui la fait plonger vers l’intérieur du Système solaire, passer au voisinage du Soleil puis repartir vers l’espace interstellaire sans jamais revenir.
Elle ne s’approche ni particulièrement près de la Terre, ni très près du Soleil. Sa distance minimale à notre planète reste de l’ordre de plusieurs centaines de millions de kilomètres, ce qui la rend inoffensive pour nous, mais aussi assez difficile à observer pour le grand public. Même à son maximum de luminosité, elle reste un objet réservé aux gros télescopes amateurs ou aux instruments professionnels.
Cette trajectoire a malgré tout offert une fenêtre d’observation en or pour les agences spatiales. L’ESA a par exemple profité de son passage près de Mars pour pointer ses sondes en orbite martienne, comme ExoMars Trace Gas Orbiter et Mars Express, afin d’affiner la trajectoire de la comète et de récolter un maximum de données sur son environnement.
Un laboratoire volant pour comprendre les comètes interstellaires
Si 3I/ATLAS génère autant d’excitation, ce n’est pas seulement pour sa rareté. C’est aussi parce que sa composition semble apporter des indices précieux sur les conditions de formation des comètes dans d’autres systèmes stellaires.
Une comète très riche en glace
Les observations réalisées avec des télescopes spatiaux et au sol montrent que 3I/ATLAS est une comète active, entourée d’une coma et d’une queue formées par la sublimation de glaces lorsqu’elle se rapproche du Soleil. Des analyses suggèrent un contenu important en dioxyde de carbone, ce qui indique une formation loin de son étoile d’origine, dans des régions très froides au-delà de la ligne de glace.
En comparant ces mesures avec celles de comètes du Système solaire, les astronomes espèrent comprendre si les ingrédients de base des systèmes planétaires sont similaires partout dans la galaxie ou si chaque étoile possède une « signature chimique » distincte.
La fameuse « radio-signature » qui a enflammé l’imagination
L’un des épisodes les plus médiatisés autour de 3I/ATLAS concerne la détection d’un signal radio par le radiotélescope MeerKAT, en Afrique du Sud. Dans l’imaginaire collectif, radio et espace riment vite avec « extraterrestres », et certains se sont empressés d’y voir un possible signe technologique.
La réalité scientifique est beaucoup plus simple et tout aussi intéressante. Les astronomes ont identifié ces signaux comme des émissions liées au radical hydroxyle (OH), produit par la dissociation des molécules d’eau dans la coma de la comète. C’est un phénomène bien connu dans l’étude des comètes : l’eau sublimée est décomposée par le rayonnement solaire, et cette chimie génère des signatures radio caractéristiques.
Cette détection est surtout historique parce que c’est la première fois qu’un signal radio de ce type est observé pour un objet interstellaire. Cela confirme que 3I/ATLAS se comporte, du point de vue de la chimie, comme une comète « classique », même si elle vient d’un autre système stellaire.
Controverse, imagination et méthode scientifique
Comme pour ʻOumuamua avant elle, 3I/ATLAS a rapidement alimenté débats et spéculations, notamment autour de l’idée qu’elle pourrait être une sonde artificielle ou un objet technologique extragalactique. Certains chercheurs, comme l’astrophysicien Avi Loeb, n’hésitent pas à souligner les particularités de l’objet et à défendre l’idée qu’il faut garder l’esprit ouvert à des scénarios non conventionnels.
Cela dit, le consensus scientifique actuel est clair : toutes les données recueillies à ce jour s’expliquent parfaitement par un scénario naturel de comète interstellaire. Sa trajectoire, sa coma, sa queue, sa chimie, ses émissions radio et son comportement général correspondent à ce que la physique prévoit pour ce type d’objet.
L’intérêt de 3I/ATLAS ne tient donc pas tant à un hypothétique caractère artificiel qu’à ce qu’elle nous permet d’apprendre sur la formation des systèmes planétaires, sur la chimie des glaces dans l’espace et sur la fréquence de ces visiteurs interstellaires autour du Soleil.
Pourquoi 3I/ATLAS passionne autant les astronomes ?
3I/ATLAS concentre plusieurs ingrédients qui la rendent irrésistible pour les scientifiques :
- c’est un objet interstellaire rare, seulement le troisième jamais observé ;
- il s’agit d’une comète active, donc riche en informations sur les glaces et la chimie interstellaire ;
- sa trajectoire offre une opportunité d’observation depuis la Terre, mais aussi depuis Mars, grâce aux sondes déjà sur place ;
- son âge probable, potentiellement plus élevé que celui du Système solaire, en fait un témoin des toutes premières phases de la formation planétaire dans la galaxie.
À chaque nouvelle campagne d’observation, 3I/ATLAS ajoute une pièce au puzzle : spectres chimiques, variations de luminosité, structures de la queue, orientation des jets de matière, etc. Toutes ces données alimentent des modèles numériques qui, à terme, aideront à mieux comprendre non seulement cette comète, mais aussi la population d’objets interstellaires dans son ensemble.
Conclusion : un nom simple pour une histoire cosmique complexe
Au départ, 3I/ATLAS ressemble à un sigle un peu froid, un code perdu dans un catalogue céleste. Une fois qu’on le décortique, il raconte pourtant une histoire complète :
- le « 3I » dit que cette comète est le troisième visiteur interstellaire officiellement identifié,
- le « ATLAS » rappelle le système qui l’a repérée en surveillant le ciel à la recherche de menaces potentielles.
Derrière ce nom se cache un voyage de plusieurs milliards d’années à travers la galaxie, une éjection violente depuis un autre système stellaire, une plongée rapide dans notre Système solaire et une mine d’informations pour les astronomes.
3I/ATLAS ne fait que passer, mais elle laisse derrière elle des données précieuses et une question enthousiasmante : combien d’autres objets comme elle traversent régulièrement notre voisinage, silencieux et invisibles, en attendant que nos instruments deviennent assez sensibles pour les repérer ?